Sommaire
général
Sommaire
posturologie
CONNAISSANCES FONDAMENTALES CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE Association ORION Office de Recherche Interdisciplinaire sur les Organisations Neurophysiologiques |
INDEX
PARTIE I : CONNAISSANCES FONDAMENTALES
- QUELQUES FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LES CAPTEURS POSTURAUX
- FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE VISUELLE
- FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE VESTIBULAIRE
- FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE PLANTAIRE
- FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'ENDO-ENTREE OCULOMOTRICE
NOTIONS GENERALES DE SYSTEME POSTURAL
- NOTIONS DE STRATEGIE ET DE TACTIQUE.
- LA STRATEGIE DE VERTICALITE CHEZ L'HOMME ET SES IMPLICATIONS
- LA MATURATION POSTURALE DE L'ENFANT A L'ADULTE.
- ANALYSE ET RÔLE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU SYSTEME TONIQUE POSTURAL
- LES CAPTEURS POSTURAUX ET ASSIMILES:
- ENTREE VISUELLE
- SYSTEME MANDUCATEUR
- ENTREE PODALE
PARTIE I :CONNAISSANCES FONDAMENTALES |
INTRODUCTION
La posturologie peut se définir par l'étude
de l'organisation géométrique et bio-mécanique des
différents segments d'un individu dans l'espace et de ses processus
de régulation ou parl'ensemble des mécanismes à substratum
neurologique permettant la stabilisation de ces éléments
dans l'espace au cours de la station debout et de la marche.
HISTORIQUE,
FAITS EXPERIMENTAUX
- Cette notion de station debout et de sa régulation,
au regard de l'évolution des espèces, est riche d'enseignements.
Il serait fastidieux ici d'en décrire toutes les étapes évolutives,
mais il faut retenir non seulement que celle-ci s'est faite très
progressivement, mais surtout qu'elle a précédé (ou
suscité?) le développement formidable de la capacité
cérébrale de l'homme moderne, non sans passer par quelques
impasses. Il faut se souvenir que la régulation posturale est donc
essentiellement automatique, soutenue par notre cerveau "primitif",
essentiellement le système limbique. Elle reste cependant l'une
des dernières acquisition fonctionnelle de notre espèce,
bien moins mature que les grandes fonctions telles la respiration, la circulation,
.. et surtout elle n'est pas supportée par tel ou tel organe spécifique
mais par une organisation complexe de relation entre diverses structures.
La fonction de verticalité chez l'homme est donc bien fragile, expliquant
ainsi la fréquence de ses dysfonctions. L'homme moderne naît
d'ailleurs avec un système postural immature!
- En fait, chez un sujet normal, le système tonique postural est d'une extrême finesse et la surface au sol décrite par un sujet debout immobile, dite en posture statique, ne dépasse pas 200 mm2, ce qui revient à dire qu'un sujet debout immobile est un sujet qui se comporte comme un pendule inversé, oscillant autour d'un axe de 4°.
HISTORIQUE ET EVOLUTION
QUELQUES FAITS EXPERIMENTAUX D'ORDRE GENERAL
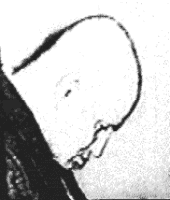
Sans consigne |
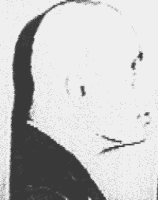
Avec consigne |
Plus près de nous, c'est Martin, en 1967, qui
a montré le premier chez un patient atteint de séquelles
d'encéphalite que le contrôle postural de la tête était
supprimé, celui-ci n'arrivant plus à la maintenir. Mais que
dès que l'on demandait à ce patient de regarder devant lui,
il était capable de redresser immédiatement la tête.
Ceci montre bien l'opposition et la complémentarité entre
le contrôle des mouvements volontaires et le contrôle automatique
(limbique) du tonus musculaire de posture.
A retenir: la gestion séparée
des mouvements volontaires et du tonus postural. |
D'après MARTIN J.P., 1967
| En ce qui concerne l'équilibre
statique de l'homme debout immobile ou en mouvement, cette fonction se
base sur une unique stratégie, celle du maintient de la projection
au sol de notre centre de gravité au centre d'une certaine surface
d'appui et notamment de la surface des pieds, qui délimitent entre
eux ce qu'on appelle le polygone de sustentation.
A retenir: la notion de stratégie de verticalité. |
|
|
|
|
A retenir: cette notion d'ajustement postural. |
Exemple de statokinésigramme |
Ainsi, parmi les différents éléments
permettant le contrôle de l'équilibre et donc de la station
debout, le premier d'entre eux est la valeur de référence
stabilisée. On suppose que cette valeur de référence
stabilisée est en réalité le centre de gravité.
En fait, le centre de gravité étant un point hypothétique
non matériel, il est difficile à étudier. On substitue
donc à l'étude du centre de gravité l'étude
du déplacement des centres de pression d'un sujet debout. Pour cela,
on met le sujet sur des plateformes de force qui enregistrent à
chaque instant la projection au sol des centres de pression (ou plus exactement,
mais cela revient à peu près au même, la résultante
des forces de réaction de la plateforme). Ces paramètres
nous renseignent sur la régulation de la position du centre de gravité.
On obtient ainsi un statokinésigramme, dont nous verrons l'importance
dans l'exploration du système tonique postural. |
- Pour étudier cette régulation de position
du centre de gravité, on utilise beaucoup également en posturologie
le test de Romberg, que nous reverrons au chapitre clinique. On
peut par exemple demander au sujet de mettre les pieds côte à
côte ou, au contraire, l'un devant l'autre, cette deuxième
possibilité constituant le test de Romberg sensibilisé et
l'on étudie la projection des centres de pression au sol, yeux ouverts
ou yeux fermés.
- A retenir: la notion de contexte moteur dans l'élaboration d'une stratégie d'équilibration.
Une preuve complémentaire a été apportée par des mathématiciens et montre comment notre système nerveux régule la position de notre centre de gravité. Pour ce type d'expérimentation, il a donc également été utilisé une plateforme de force. Ce travail a consisté à analyser mathématiquement le chemin parcouru par le déplacement des centres de pression chez un sujet debout immobile. Sans entrer dans les détails de l'analyse mathématique, il a été démontré que le système nerveux contrôlait ces déplacements en boucle ouverte, c'est à dire que le mouvement de la projection des centres de pression est complètement aléatoire, dans une certaine zone de l'équilibre mais qu'ensuite, à partir d'un certain point critique, la régulation en boucle ouverte se transforme en une régulation en boucle fermée, c'est à dire qu'à partir de ce moment, les afférences proprioceptives vestibulaires et visuelles concourent à la régulation de la projection des centres de pression.- En effet, les mesures ont été faites en situation yeux ouverts puis yeux fermés. Dans ce cas, on peut identifier deux populations différentes d'individus possédant deux stratégies différentes pour contrôler la projection au sol des centres de pression. Ces deux populations d'individus peuvent se distinguer en comparant les courbes et la situation du point critique entre la situation yeux ouverts et la situation yeux fermés.
- Pour une première population, le contrôle de la projection des centres de pression, en situation yeux fermés, se fait par rapport à la situation yeux ouverts en boucle ouverte, c'est à dire par augmentation de la raideur de l'articulation de la cheville.
- L'autre type de population de patients agit par régulation
sur la boucle fermée, par augmentation du gain des retours proprioceptifs
vestibulaire et visuel, c'est à dire que le sujet se sert beaucoup
plus rapidement de ses informations sensorielles pour contrôler son
équilibre. C'est ainsi que l'on peut étudier comment le sujet
contrôle son équilibre par analyse de la projection des centres
de pression.
- A retenir: les stratégies d'équilibration
ne sont pas uniques et stéréotypées mais variantes
d'un individu à un autre selon son acquis antérieur.
- A côté de cette valeur de référence
stabilisée, un autre facteur important du contrôle postural
est constitué par les informations données par les différents
capteurs posturaux, qui se comportent en véritables signaux détecteurs
d'erreur.
La question que l'on peut se poser est la suivante: "Comment l'organisme sait-il qu'il se dévie de sa position d'équilibre?"
Les expériences suivantes montrent que les différentes modalités de détection des erreurs par rapport à la position d'équilibre agissent soit de façon complémentaire, soit de façon comparative. Ces expériences ont été menées par le Professeur Roll.
| Une équipe de biomécaniciens du groupe
de Winter a montré en fait que nous utilisons différentes
stratégies de contrôle de l'équilibre totalement dépendantes
de la position de nos pieds au sol. Dans le cas où les pieds se
trouvent l'un à côté de l'autre, la position du centre
de pression est régulée au niveau latéral par la position
des hanches, alors qu'en antéro-postérieur, la position est
régulée par l'articulation des chevilles. Par contre, quand
le sujet est en position de Romberg sensibilisé, un pied devant
l'autre, la régulation de l'équilibre latéral est
prise en charge, cette fois-ci, par l'articulation des chevilles, régulation
très rapide, tandis que le contrôle antéro-postérieur
se fait par l'articulation des hanches.Cette expérience montre bien
que la stratégie utilisée dépend de nos conditions
d'appui et de notre polygone de sustentation.
|
Effet de la position des pieds au sol sur l'axe
des oscillations posturales |
- Dans ce type d'expérimentation,
le sujet est en situation yeux fermés, debout contre un plan dur
qui l'informe en permanence de sont immobilité, et l'on provoque
une vibration du muscle gastrocnémien (au niveau du tendon d'Achille)
à une fréquence de 70 Hz environ. Ceci a pour conséquence
de provoquer une sensation d'étirement de ce muscle, comme si le
sujet était penché en avant. (Le sujet à l'illusion
de se pencher en avant, en réalité il ne bouge pas.)
Si le sujet n'est pas maintenu, il se penche en arrière pour rétablir l'équilibre et il tombe.
Si l'on fait la même expérience mais les yeux ouverts, le sujet se rend bien compte que l'environnement visuel ne bouge pas, par contre, il perçoit une impression de dorsiflexion de la cheville ou il a l'impression d'être penché en avant. Ceci montre bien que la même information est traitée différemment par le système nerveux central selon les informations fournies par les autres capteurs, c'est-à-dire selon le contexte sensoriel (on parle alors de paysage proprioceptif).
A retenir: L'effet réel ou perçu en tant que tel d'une stimulation ou d'une information en provenance d'une entrée posturale peuvent être différents selon le contexte sensoriel.
- Les expériences que l'on va décrire maintenant ont été présentées par le Professeur Berthoz, du Collège de France.
- Ces séries d'expériences ont été
décrites tout à fait récemment par Melvill Johnes.
Melvill Johnes a beaucoup travaillé sur l'adaptation et en particulier
sur la plasticité cérébrale, c'est à dire cette
capacité extraordinaire que possède le système nerveux
central à organiser les relations naturelles entre les sens. M.
Johnes pose l'idée qu'en dehors des grands systèmes de contrôle
de la posture, qui ont été bien décrits, et qui mettent
en jeu la vision, le système vestibulaire, la proprioception, il
y aurait un autre système qui est encore très incompris et
qui concerne l'ensemble des phénomènes de la motricité
des jambes et des pieds.
- Melvill Johnes a pris des sujets et il les a fait marcher
sur un plateau tournant.
- On fait donc marcher le sujet dans cette situation de
conflit, pendant vingt minutes environ; pour s'adapter à cette situation
le cerveau doit effectuer en fait, pour résoudre ce conflit sensoriel,
une recalibration entre les informations visuelles, une reconfiguration
des relations entre le système vestibulo-visuel et le système
locomoteur et proprioceptif des jambes et des pieds. Ce qu'a découvert
Melvill Johnes c'est qu'à la suite de cette recalibration, il y
avait une modification considérable de l'interprétation par
le cerveau des informations locomotrices en provenance des jambes et des
pieds.
- Avant de voir les résultats de cette expérience,
il faut rappeler certains travaux allemands qui ont consisté à
mesurer les seuils de perception des différents capteurs posturaux,
en particulier labyrinthique et seuil de perception du mouvement au niveau
de la cheville. Ces travaux ont montré que les seuils de perception
au niveau de la cheville sont à peu près deux fois plus faibles
que les seuils pourtant exquis et remarquablement bas de la détection
du mouvement par les canaux semi-circulaires. La cheville est donc capable
de détecter des variations d'orientation du corps avec une précision
remarquable.
- La signification de ceci est que le sujet a été
capable de recalibrer l'information proprioceptive donnée par la
cheville pour l'adapter à un contexte qui était devenu conflictuel.Si
après cela on fait asseoir le sujet sur un fauteuil roulant, et
qu'on lui demande de faire le même trajet mais, cette fois-ci, en
se déplaçant avec les bras en poussant les roues, le trajet
reste rectiligne que ce soit avant ou après recalibration, ce qui
prouve que la recalibration impliquait vraiment un système segmentaire
et non central.Ceci met en évidence l'existence d'un mécanisme
d'adaptation qui implique le système locomoteur et proprioceptif
des membres inférieurs, donc qui est bien un système segmentaire
et qui n'a rien à voir avec un système vestibulaire. Bien
sûr, cette adaptation a une certaine durée mais elle dure
remarquablement longtemps. Il faut, en effet, trente à quarante
minutes pour que la vitesse angulaire de la rotation s'atténue.
Il s'agit donc d'un pénomène de recalibration de l'interprétation
des informations sensorielles ou motrices des jambes relativement durable.
- Si l'on fait une autre expérience qui consiste
à demander au sujet de marcher sur place, tout en effectuant une
rotation, relativement lente, de 30 à 40 degrés par seconde
pendant une demi-heure, on obtient encore une situation similaire. En effet,
dans ces conditions, il n'y a pas de stimulation canalaire, le système
des canaux semi-circulaires horizontaux n'est pas stimulé, puisqu'on
est à vitesse constante et qu'on est en dessous des seuils de perception
canalaires. Dans ces conditions on crée donc là aussi un
conflit puisque la proprioception des membres inférieurs dit "qu'on
était en train de marcher en tournant", la vision dit également
cette chose-là, mais le système vestibulaire ne le détecte
pas. Maintenant, si l'on demande au sujet de continuer à marcher
les yeux fermés, et de ne plus tourner, le sujet qui a l'air parfaitement
stable, qui perçoit une marche stable, se met à tourner,
alors que les sujets disent qu'ils sont parfaitement stables et certifient
ne pas tourner.
- Le temps de disparition de cet effet est de l'ordre de
quarante minutes, comme dans l'expérience de Melvill Johnes. On
met là encore en évidence une recalibration des relations
qui est du même ordre que précédemment.
- J'ai pris ces expériences pour montrer qu'il existe
réellement une possibilité de reprogrammation segmentaire
très puissante à partir du moment où l'on crée
une situation de conflit d'information et que le sujet est alors contraint
de recalibrer entièrement sa posture et ses commandes motrices.
- A retenir: La plasticité des systèmes sensoriels intervenant dans la posture est très grande. La posture accepte rapidement de nouvelles informations et se réorganise en conséquence dans l'espace. Les seuils de perception de la cheville et des membres inférieurs sont très bas.
|
D'après Roll - 1994 |
|
| Le sujet est debout, sur un plateau qui tourne à vitesse constante et, alors que les pieds marchent sur le plateau, le sujet tient entre les mains une barre qui le fixe dans l'espace. Donc, le sol se déplace sous lui et l'ensemble de la proprioception des jambes et des pieds et les commandes motrices de l'ensemble de l'appareil locomoteur envoie des informations de déplacement dans l'espace, alors que le système vestibulaire et la vision disent au cerveau que le corps, lui, ne se déplace pas. Il y a donc une différence, une dyscongruence entre ce que disent la vision et les labyrinthes, qui disent que le sujet est parfaitement stable dans l'espace, et ce que disent l'ensemble des informations motrices proprioceptives et sensorielles des pieds et des membres inférieurs. | Expérience de Melvill Johnes |
Expérience de Melvill Johnes. |
Après avoir demandé à ce sujet de marcher sur ce plateau, et l'en avoir fait descendre, il lui est demandé de marcher tout droit, les yeux fermés. Dans une telle situation le sujet normal marche tout droit bien entendu mais, après adaptation et recalibration sur plate-forme tournante, le sujet à qui on demande de marcher droit, les yeux fermés, décrit en fait une trajectoire courbe qui reproduit le sens de rotation de la plate-forme mobile précédente. |
QUELQUES
FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LES CAPTEURS POSTURAUX
- Ceci montre le gain constant (normalement) apporté par l'entrée visuelle sur l'ensemble de la régulation posturale.
FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE VISUELLE
| Le plus simple moyen de faire varier l'entrée
visuelle d'un sujet en expérience est de lui faire fermer les yeux.
On peut ainsi obtenir par stabilométrie une quantification de la
variation apportée par cette action sur l'équilibre, que
l'on appelle quotient de Romberg. Comme ce paramètre dépend
des conditions de l'environnement visuel, celui-ci est toujours standardisé
pour un examen sur plate-forme.
Selon les conditions standard, la valeur de ce quotient
est de 250, c'est-à-dire que la précision du système
postural fin doit être de 250 % supérieure en situation yeux
ouverts par rapport à la situation yeux fermés. Mesure du quotient de Romberg (poids de l'entrée visuelle) sur plate-forme de stabilométrie |
Modification du spectre d'amplitude Yeux ouverts/Yeux fermés |
L'information visuelle est transmise au système
postural par un appareil sensoriel qui présente une certaine fonction
de transfert. Cette fonction est inconnue, mais on pouvait se demander
si elle ne commandait pas une efficacité plus particulière
de l'entrée visuelle dans une certaine bande de fréquence
des oscillations posturales; de nombreux auteurs ont en effet décrit
que l'entrée visuelle surveillait les basses fréquences.
L'expérimentation a montré qu'il n'en était rien et
que la présence des informations visuelles réduisait les
valeurs du spectre d'amplitude des oscillations posturales sur toute l'étendue
du spectre (0 - 0,5 Hz) contrôlée par le système postural
lorsque l'on compare les deux situations yeux ouverts et yeux fermés.
|
FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE VESTIBULAIRE
- La façon la plus naturelle de stimuler le vestibule est évidemment de le soumettre à des accélérations linéaires ou angulaires.
- Walsh a utilisé pour cela une plate-forme oscillante
dont l'axe de rotation était en dessous du plan de sustentation
du sujet. Le corps étant assimilé à un pendule inversé,
on estime que les oscillations de la plate-forme sont transmises aux vestibules,
qui sont donc ainsi soumis à des accélérations angulaires
sinusoïdales agissant sur les canaux semi-circulaires antérieurs
et postérieurs essentiellement.
- Pour des oscillations de la plate-forme inférieures
à 0,06 Hz., le corps oscille dans l'environnement et non par rapport
à la plate-forme. Pour des fréquences supérieures,
apparaissent des réponses vestibulaires tendant à stabiliser
le corps par rapport à l'environnement et donc faisant apparaître
des oscillations angulaires au niveau des chevilles.
|
Ceci montre que les vestibules ne sont stimulés que pour des oscillations de fréquence supérieure à 0,06 Hz. |
FAITS
EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'EXO-ENTREE PLANTAIRE
SUR LE PIED EN GENERAL
| Lorsque l'on augmente les surfaces de contact entre la
peau des pieds d'un sujet et son environnement en lui faisant porter des
chaussures montantes, on améliore les performances de son système
postural fin. On constate en effet sur plate-forme de stabilométrie
une réduction de la surface du statokinésigramme et une diminution
de l'amplitude des oscillations posturales dans les fréquences contrôlées
par le système, entre 0 et 0,5 Hz.
Ceci montre l'effet postural et neurologique de l'extéroception cutanée. |
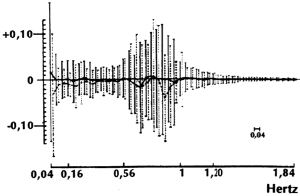 |
SUR LES SOLES PLANTAIRES
- Lorsque l'on modifie la surface de contact de la sole
plantaire en disposant régulièrement sur la plate-forme des
plombs de chasse de deux millimètres de diamètre, à
demi enchâssés dans un support dur, on constate une réduction
de la surface des statokinésigrammes qui varie en fonction de l'écartement
des grains de plombs.
|
De plus, la comparaison des surfaces de statokinésigramme ainsi obtenues en situation yeux ouverts puis yeux fermés suggère une meilleure utilisation de l'entrée plantaire dans ce dernier cas.
|
AUTRES EXPERIENCES SUR LA STIMULATION DES SOLES PLANTAIRES
| Lorsque l'on stimule sélectivement certaines régions
des zones plantaires, soit de façon continue en plaçant une
surélévation de 1,2 mm. sous cette région, soit de
façon discontinue par un jeu de cales mobiles de 1,2 mm. de hauteur
apparaissant et disparaissant à un rythme rapide et aléatoire,
on constate une déviation du centre de pression dont la direction
est corrélée à la position de la stimulation. Une
stimulation sous-capitale provoque une déviation vers l'avant du
centre de pression, une stimulation sous-tubérositaire provoque
une déviation vers l'arrière du centre de pression (Fujiwara,
1992).
Vue la hauteur des cales utilisées, on pense que
cette stimulation est de nature proprioceptive. Nous verrons plus loin
ce qu'il peut se passer sur un statokinésigramme quand on augmente
progressivement cette hauteur de cale. |
FAITS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'ENDO-ENTREE OCULOMOTRICE
| Dans les années 70, Roll
et collaborateurs ont mis en évidence que les terminaisons dynamiques
des fuseaux neuro-musculaires (zones primaires) étaient particulièrement
sensibles à des étirements de très faible amplitude
et répétés, c'est à dire à des vibrations.
L'organisation et la nature du message sensoriel ont été
étudiés par une méthode de micrographie. On met alors
en évidence, en réponse à ce type de stimulation,
des réponses posturales orientées selon les muscles oculomoteurs
vibrés. La réponse se fait en arrière pour les droits
inférieurs, en avant pour les droits supérieurs, latéralement
d'un côté ou d'un autre selon le groupement des muscles droits
externes et droit internes stimulés. |
NOTIONS GENERALES DE SYSTEME POSTURAL
- L'ensemble des données que nous venons de voir
met en évidence la complexité du système tonique postural,
dont nous rappelons que le rôle est la stabilisation de l'homme dans
son environnement, stabilisation obtenue d'une part par la lutte contre
la pesanteur, et nous venons de voir le rôle anti-gravitaire des
muscles posturaux en relation avec les informations vestibulaires, et par
la stabilité du regard, qui met en jeu essentiellement des informations
visuelles et proprioceptives des muscles moteurs oculaires externes. Il
est donc possible d'aborder à ce stade le système tonique
postural comme un système à multiples entrées et à
multiples réponses, c'est à dire multiplexé et
multimodal.
- Les entrées sensorielles
se comportent en terme de fournisseurs d'informations d'une part, internes
ou externes (endo-entrées et exo-entrées), de détecteurs
d'erreurs d'autre part.
- La régulation centrale élabore
une réponse, puisée dans ses propres répertoires moteurs,
qui lui semble la plus adaptée à la situation et selon des
schémas tactiques qui dépendent des circonstances cognitives
et de la richesse de l'acquis moteur. La réponse se fait par le
contrôle du tonus musculaire des muscles anti-gravitaires, dont la
modification induit une variation des information fournies par les capteurs
posturaux, qui se comportent ainsi en détecteurs d'erreur.
- Comprendre la notion de concept postural n'est pas simple. Cela implique une vision quelque peu différente du patient, de la maladie et de l'action thérapeutique. L'idée même de diagnostic postural doit être reconsidérée par rapport à celle de diagnostic tel qu'il est normalement compris et accepté par le médecin praticien, spécialisé ou non. Attention toutefois, cette notion de pathologie posturale n'exclue absolument pas les autres diagnostics, et l'association d'une pathologie posturale (fonctionnelle) à d'autres pathologies notamment lésionnelles est des plus fréquente.
|
Schéma simplifié de la régulation posturale |
La posture érigée est une fonction physiologique, la maladie posturale est une perturbation fonctionnelle, même si elle peut avec le temps entraîner ou favoriser des lésions.
NOTIONS DE STRATEGIE ET DE TACTIQUE.
- Le but de la fonction posturale étant le maintient de la verticalité, il va de soi que l'être humain développe pour cela une série de moyens organisés en système, une série de boites noires. Je me permets d'insister, en accord total avec le Docteur Weber qui en a parlé le premier, sur quelques notions qui ont leur importance pour une correcte compréhension du champ d'étude de la posturologie.
- Il est souvent fait une confusion entre la notion de stratégie et de tactique. Quand on replace ces notions dans le champ de la théorie des systèmes on en retire quelques enseignements et une amélioration de l'examen posturologique et des traitements.
- Il faut d'abord insister sur le fait qu'il existe une plasticité extraordinaire de l'ensemble des systèmes de régulation qui régissent la posture. Par exemple, quand on fait poursuivre une cible à un chat et que l'on arrête brusquement sa tête dans son mouvement, le regard continue la poursuite sans arrêt, comme s'il y avait déjà en place des schémas à l'avance qui permettraient, malgré l'arrêt inopiné du mouvement, au système de continuer à fonctionner. Il y avait donc une stratégie de rechange qui était déjà en place prête à être utilisée. Cette notion n'est jamais à perdre de vue, l'effet d'un traitement postural aboutissant presque toujours, s'il est correct, à la mise en place d'une nouvelle "stratégie", plus performante ou différente.
- Si l'on reprend des définitions, on définit une stratégie comme un ensemble d'actions coordonnées pouvant mener à une victoire, ou un ensemble de moyens coordonnés que l'on emploi pour aboutir à un résultat. La tactique, qui s'oppose dans un certain sens à la stratégie, est l'art de combiner tous les moyens en exécution locale pour l'adapter aux circonstances et contraintes des plans de la stratégie.
- Dans le domaine de la motricité, on parle de synergies en lieu et place de tactique, c'est-à-dire des éléments précablés appartenant au répertoire moteur, que d'autres pourraient appeler des réflexes orientés, permettant de faire un mouvement de façon quasi automatique, puisque seul le but à atteindre est clairement formulé par le cortex cérébral, le reste s'exécutant automatiquement selon son propre acquis moteur. La posturologie, dans son maintient de l'équilibre, fait appel à des synergies élémentaires.
- Si l'on reprend la généralité de la théorie des systèmes, au sein d'un système régulé un certain nombre de facteurs agissent sur le système, dont l'effet comporte une boucle de rétroaction affectant en retour un ou plusieurs facteurs. Dans des systèmes de régulation plus complexes, il intervient sur la boucle de rétroaction un système extérieur qui va en modifier le niveau de l'effet, que l'on appelle une consigne. Par exemple, quand un pilote d'avion enclenche le pilotage automatique, il fixe le cap et le système essaie de maintenir ce cap dans les limites du système de régulation. Cet ensemble définit ce que l'on appelle un niveau d'organisation, c'est-à-dire un ensemble qui est cohérent et qui se définit par son effet, c'est-à-dire par le but à atteindre.
- Dans la réalité biologique, les systèmes sont d'un niveau logique beaucoup plus complexe qui fait que les effets d'un système cohérent viennent influencer un autre système du même type dont l'effet peut lui aussi retentir sur d'autres systèmes, et quand on essaie d'analyser de manière linéaire des systèmes tels que cela, on ne sait jamais par quel bout commencer. En fait, le niveau d'observation va être subjectivement défini par l'observateur en fonction de l'effet qu'il a choisi d'observer, et l'on va multiplier les niveaux d'analyse afin de dresser un tableau de l'ensemble.
- A l'heure actuelle, l'évolution des idées se fait vers la compréhension des phénomènes en terme de systèmes pseudo-stables, capables de choisir entre plusieurs comportements différents.
- Le système postural, assimilé à un pendule oscillant à l'envers selon une déviation de 4° d'axe de part et d'autre, peut être assimilé et étudié comme un système cohérent dont l'effet est de maintenir la projection du centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation. Ceci est la stratégie du système tonique postural.
- Mais pour y parvenir, l'ensemble des sous-systèmes qui composent le système tonique postural emploie plusieurs tactiques possibles.
- L'analyse de la posture d'un sujet aura donc pour objet de faire un certain nombre de tests sur les différents éléments qui la composent, qui sont en fait la possibilité d'imaginer ce qui se passe dans la boite noire, dont nous n'avons pas le détail et que nous n'arrivons pas à suivre dans l'enchaînement des effets et régulations, de manière à établir une corrélation entre une variation d'entrée et un effet de sortie. On essaie d'analyser, décortiquer, découvrir une tactique dans la stratégie de la verticalité. Le but d'un examen postural est bien d'analyser comment un sujet, dans sa propre dynamique, utilise une ou plusieurs tactiques pour maintenir sa stratégie, et l'ambition d'un traitement postural n'est pas tellement de reprogrammer une nouvelle tactique plus performante, ni de corriger un défaut s'il existe ou une dysrégulation qui existerait de manière stable, mais de proposer au sujet un nombre de tactiques augmenté pour qu'il puisse utiliser celle qu'il devra mettre en oeuvre au moment où il en aura besoin.
- Toutes les techniques de rééducation de la posture, de manipulations ou corrections des capteurs et de rééducation de la proprioception ne sont que des occasions de réutiliser des tactiques que le sujet n'avait jamais utilisé ou qu'il avait perdu et d'augmenter l'éventail de ses possibilités pour que, face à des situations d'environnement très variables, il puisse mieux se débrouiller qu'avec la ou les tactiques qu'il utilise habituellement.
- L'acquisition de nouvelles tactiques se fait par construction, par recomposition à partir de synergies motrices élémentaires du répertoire moteur, parfois oubliées ou inopérantes, telles que nous en avons parlé plus haut, afin d'accéder au but recherché.
LA STRATEGIE DE VERTICALITE CHEZ L'HOMME ET SES IMPLICATIONS
- Dès sa naissance, l'être humain entame un apprentissage de la station verticale, une acquisition et une optimisation de son répertoire moteur et de ses différentes tactiques, qui ne seront complètement matures que vers l'âge de 12 à 13 ans. Auparavant, il est coutume de dire que le système postural n'est pas mature; il est alors d'autant plus sensible à des facteurs de perturbation internes ou externes, mais d'autant plus malléable, plastique et tolérant.
- S'intéresser à l'histoire de l'évolution de ces tactiques et de leurs différentes composantes est du plus haut intérêt, car on n'aborde pas la posture de l'enfant comme celle de l'adulte.
- Classiquement, et cela est aussi valable pour l'adulte, on distingue trois types d'informations sensorielles qui sont au service du contrôle de l'équilibre: les informations visuelles, les informations réticulaires et les informations somato-sensorielles.
- L'enfant, comme l'adulte, a à sa disposition ces trois types d'informations qui concourent à la construction du système tonique postural. Cependant, certaines contributions sensorielles sont dominantes au cours de certaines phases de ce développement.
- Les diverses tactiques d'équilibre de l'enfant comme de l'adulte reposent sur deux principes fonctionnels:
- - le choix de la référence stable à partir de laquelle s'organise le contrôle de l'équilibre,
- - la maîtrise des degrés de liberté des différentes articulations du corps.
- Toute activité posturo-cinétique peut s'organiser à partir de deux types de support:
- - soit le support sur lequel se tient le sujet,
- - soit la verticale gravitaire.
Dans le premier cas, le sujet se réfère
principalement à la proprioception qui émane de ses effecteurs,
il organise son équilibre de façon ascendante, du pied jusqu'à
la tête. Dans le second cas, il prend appui en quelque sorte sur
la verticale gravitaire en stabilisant sa tête dans l'espace par
l'information vestibulaire, et donc de façon descendante à
partir de la stabilisation de sa tête jusqu'aux pieds. Ces deux types
de fonctionnement, ascendant et descendant, correspondent à deux
grandes unités fonctionnelles, tête, cou et tronc d'une part,
dont nous ne distinguerons pas ici les différentes tactiques selon
que la tête est solidaire du tronc par rapport à l'espace
ou au contraire mobile, pied, articulation tibio-tarsienne, ligaments croisés
des genoux et bassin d'autre part. Dans tous les cas, le rachis dorsal
moyen est le lieu de jonction entre ces deux unités fonctionnelles.
LA MATURATION POSTURALE DE L'ENFANT A L'ADULTE.
- L'évolution de la construction et de l'acquisition des différentes stratégies posturales chez l'enfant se fait en plusieurs stades, où le rôle de l'information visuelle péripérique est permanent.
- De la naissance à un peu plus d'un an environ (acquisition de la marche), l'apprentissage est descendant, céphalo-podal, la tête et le vestibule jouant le rôle essentiel dans l'acquisition de la posture, avec fonctionnement articulé tête-tronc. Le bassin est stabilisé dès 2 mois d'apprentissage de la marche.
- De l'acquisition de la marche à 6 ans l'organisation se fait de façon ascendante, podo-céphalique et à partir des hanches stabilisées et privilégie un fonctionnement en bloc de l'ensemble tête-épaule.
- Vers 7 à 8 ans il s'instaure un retour de l'organisation descendante de l'équilibre, avec prédominance vestibulaire transitoire, la tête devient immobile dans l'espace, en reprenant sa mobilité sur les épaules.
- De 8 à 13 ans l'organisation devient progressivement à double sens pour se rapprocher de celle de l'adulte.
- Au-delà, c'est celui de l'adulte, où il y a dissociation complète tête-tronc sauf dans les mouvements de roulis et une harmonisation des différentes informations qui circulent aussi bien en ascendant qu'en descendant.
- Nous verrons l'importance de ces divers stades et de leurs implications thérapeutiques chez l'enfant.
- Chez l'adulte, le système postural est complètement mature et il doit être étudié dans sa totalité, comme nous l'avons dit précédemment. Selon que l'on s'adresse en priorité à une étude de l'équilibre, à une étude du mouvement et sa coordination, à une étude des déformations spatiales, les méthodes employées divergent quelque peu afin d'identifier les éléments visuels, réticulaires et somato-sensoriels à l'origine d'un trouble ou d'une plainte. Il est cependant fort important de ne jamais perdre de vue que tous ces aspects sont sous-tendus en totalité par la notion de concept de système postural fin, notion réduite à la régulation de l'homme debout dans un cône de 4°.
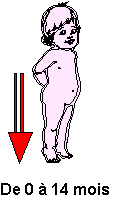 |
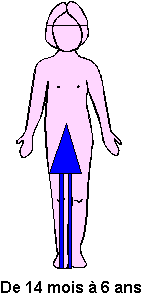 |
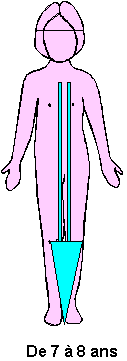 |
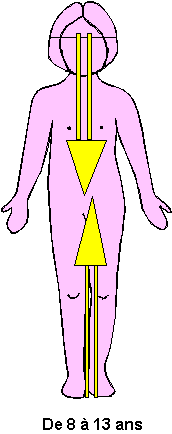 |
ANALYSE ET RÔLE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU SYSTEME TONIQUE POSTURAL
- Le système postural implique les notions d'entrées
et de sorties. Les entrées correspondent aux informations sensorielles
et sensitives fournies par des exocapteurs et des endocapteurs. Les sorties
correspondent aux réponses motrices stéréotypées
et automatiques, elles sont exécutées par l'effecteur musculaire.
Entre les deux se situe la régulation centrale.
Nous étudierons successivement: - Il s'agit de capteurs sensoriels agissant comme des fournisseurs
d'information et des détecteurs d'erreur. Ils informent en permanence
sur la position des différents segments du corps les uns par rapport
aux autres et globalement du corps par rapport à l'environnement
(fournisseurs d'information) mais aussi et surtout de la moindre variation
de ces informations (détecteurs d'erreurs).
- Il donne deux types d'informations:
- - une information visuelle d'une part, liée à
la transmission au système nerveux central de l'image rétinienne
et de ses variations dans le temps,
- une information oculo-motrice d'autre part, liée à la tension des muscles oculo-moteurs externes.
LES CAPTEURS POSTURAUX ET ASSIMILES
LES CAPTEURS CEPHALIQUES
LE CAPTEUR OCULAIRE
INFORMATION RETINIENNE
- La vision donne des informations à la fois sur la position et sur le mouvement du corps dans l'espace. Ceci se fait grâce à la rétine.
- On a pu démontrer que celle-ci transmet deux types d'informations visuelles.
- L'oculomotricité fournit au système nerveux des informations de type totalement différent, puisqu'elle ne fournit pas d'informations en provenance du milieu extérieur (exocapteurs) mais des informations en provenance du milieu intérieur (on parle d'endocapteurs). On dit que l'oculomotricité est une endo-entrée.
- L'oculomotricité est sous-tendue par un certain nombre de muscles oculomoteurs externes, au nombre de six, dont l'innervation est dépendante du V pour le muscle droit externe, du IV pour le muscle grand oblique et du III pour les muscles droit supérieur, droit inférieur, droit interne et petit oblique.
Ces muscles ont une grande particularité, non seulement ce sont des effecteurs au sens motricité visuelle mais ils sont aussi sensitifs puisqu'ils contiennent des filets nerveux sensitifs en provenance du système neurovégétatif; les muscles oculomoteurs externes sont des récepteurs proprioceptifs grâce aux fuseaux neuro-musculaires d'une part et à la jonction musculo-tendineuse où se trouvent des organes sensibles à l'étirement dits en palissade d'autre part.- Les voies de la proprioception oculomotrice ont été particulièrement étudiées par une équipe du Collège de France autour de Pierre BUISSERET dans les années 70, et on accorde à sa collègue Madame GARRY BOBO d'avoir décrit le cheminement de ces voies par la branche ophtalmique du trijumeau, avec une répartition des corps neuronaux en partie dans le ganglion de GASSER, en partie dans le noyau descendant du trijumeau. Cette particularité anatomique est importante car elle permet de couper (en expérimentation animale) facilement et sélectivement l'information proprioceptive oculomotrice.
- Cette proprioception oculomotrice donne au système nerveux la position exacte de l'oeil dans l'orbite.
- Les différentes expériences ont montré que ces muscles oculomoteurs externes codent le mouvement grâce aux informations qu'ils fournissent, non pas en provenance du muscle qui se contracte sous la commande motrice mais en provenance du muscle qui se laisse étirer par la commande motrice (muscle antagoniste). On dit que c'est l'antagoniste qui code le mouvement.
- La musculature extra-oculaire intervenant dans la stabilisation de l'oeil et dans le contrôle des mouvements oculaires contient des récepteurs musculaires et tendineux ou organes de Golgi.
- Il est possible expérimentalement de simuler un étirement musculaire en faisant vibrer un muscle. Certains travaux en particulier ceux de Roll ont montré que cela induisait un effet postural. Si l'on fait vibrer par exemple le droit externe droit et le droit interne gauche, qui sont des muscles conjugués, on entraîne un déplacement du corps à gauche. Si l'on fait vibrer les deux droits supérieurs, on entraîne un déplacement du corps en avant. (voir plus haut)
- Mais il existe des relations entre la proprioception et la vision et des relations entre la proprioception, la vision et la cognition.
- Ainsi, les exemples précédemment cités s'accompagnent d'un effet kinesthésique, c'est à dire une illusion de mouvement. Si, comme dans la solution précédente, on fait vibrer le droit externe droit, on provoque une illusion de rotation de la tête à gauche. Si l'on immobilise la tête, on obtient une illusion de rotation du tronc à gauche. Si c'est le droit externe gauche qui est stimulé, la réaction se fait dans l'autre sens. On obtient également un effet visuel par illusion de déplacement de point lumineux fixé.
- Quant aux afférences maculaires (organes otolithiques),
ils transmettent des informations sur la position de la tête dans
l'espace et sur l'accélération des déplacements.
Il faut bien connaître les limites de ce système. Elles sont les suivantes:- 1) - Le système n'est sensible qu'aux accélérations, il ne fournit donc aucune information quand le sujet est immobile ou mobile à vitesse constante.
- 2) - Le système possédant ses propres propriétés physiques, il ne peut transmettre des informations pertinentes que pour des vitesses élevées de mouvement. En situation debout immobile, chez le sujet sain, le système ne transmet aucune information.
- 3) - Le capteur cupulaire n'est pas capable de distinguer
le sens d'une accélération, tandis que le capteur maculaire
n'est pas capable de distinguer le vecteur gravitaire du vecteur d'accélération
inertielle.
- On appelle système manducateur l'ensemble des organes participant à l'acte de manger, c'est à dire la préhension de l'aliment, la mastication et la déglutition. Le système manducateur intervient dans la régulation du système tonique postural non comme un capteur à proprement parler mais comme un élément ajouté dont le rôle est généralement perturbateur. Du fait de son innervation par le V, sa perturbation se fait souvent en liaison avec les informations de la proprioception des muscles oculomoteurs externes. Dans de rares cas, le système manducateur peut être l'objet de dysfonctionnements voire de lésions consécutives ou adaptatrices à certaines formes de dysrégulation posturale.
- Nous l'aborderons donc essentiellement au chapitre de la pathologie et nous distinguerons ses différents éléments constitutifs d'une part et les perturbations engendrées au niveau mécanique (denture et articulations temporo-mandibulaires), au niveau musculaire et au niveau neurologique réflexe d'autre part.
| La vision focale (ou vision fovéale) sert à l’identification des objets et donne la direction du regard par rapport à la position de la tête et du corps. La vision périphérique donne des informations sur l’orientation du sujet par rapport à son environnement, en particulier elle transmet des informations relatives au mouvement de l’environnement par rapport à la rétine et c’est donc un type de vision particulièrement impliqué dans l’équilibre dynamique. |
INFORMATION OCULOMOTRICE
LE SYSTEME VESTIBULAIRE ET LABYRINTHIQUE
| Le système vestibulaire et labyrinthique joue
un rôle majeur dans la régulation posturale. Ce système
donne des informations de mouvement quand le sujet est soumis à
des accélérations angulaires qui stimulent les cupules des
canaux semi-circulaires ou des accélérations linéaires
qui stimulent les macules des organes otolithiques.
Chaque canal possède sa propre orientation géométrique, chaque canal devenant sensible uniquement aux accélérations dans son propre plan géométrique. |
Disposition géométrique des canaux semi-circulaires |
LE SYSTEME MANDUCATEUR
LE CAPTEUR PODAL
- Quand on s'intéresse au système postural, le pied doit toujours être étudié. Capteur primaire du système tonique postural, avec l'oeil et le vestibule, il intervient dans toutes les situations qu'elles soient statiques ou dynamiques en station verticale. En effet les soles plantaires indiquent en permanence la pression différentielle entre les deux voûtes plantaires, permettant ainsi de percevoir les irrégularités du sol et d'adapter des réflexes d'équilibre en conséquence.
- On distingue au niveau du pied deux type de capteurs: des capteurs proprioceptifs (corpuscules tendineux, articulaires et musculaires) qui n'ont rien de particulier à ce niveau, et des capteurs extéroceptifs.
- Les propriocepteurs sont des récepteurs kinésthésiques,
ce sont des récepteurs diffus.
- - Les récepteurs musculaires sont constitués de fuseaux neuro-musculaires, sensibles à l'étirement et qui assurent par le réflexe myotatique le tonus des muscles posturaux anti-gravitaires.
- - Au niveau des tendons, il s'agit des organes de Golgi, ces organes sont sensibles à l'étirement.
- - Les récepteurs ostéo-articulaires: se sont les corpuscules de Vater Pacini, ils renseignent sur la position des différentes articulations les unes par rapport aux autres.
- Mais se sont surtout les capteurs de l'extéroception que nous allons principalement aborder.
- Le pied a de plus la particularité d'avoir à la fois :
- - des exocapteurs : il s'agit des baro-récepteurs de la sole plantaire (corpuscules de Pacini entre autres);
- - des endocapteurs : il s'agit des faisceaux neuro-musculaires situés dans les muscles et les tendons de la cheville (appareil de Golgi).
- Aussi, peut-on dire que la position des pieds par rapport à la tête est connue par l'intermédiaire des muscles du cou et du rachis. (La notion de proprioception mérite les explications suivantes : elle peut se définir comme une sensibilité particulière issue du corps du muscle et de ses tendons : tous deux contiennent des récepteurs sensibles à l'étirement. Il s'agit d'une sensibilité inconsciente par opposition à la sensibilité consciente).
- On a démontré qu'il existe une chaîne musculaire qui est en même temps une chaîne de sensibilité proprioceptive se développant de l'oeil au pied.
- De nombreux travaux mettent par ailleurs en évidence des corrélations entre la sensibilité de la voûte plantaire et l'équilibration.
- Quand on regarde au microscope la structure de la voûte plantaire, on se rend compte que celle-ci est envahie par une double couche de filets nerveux, ce double réseau portant un certain nombre de récepteurs, dont certains sont visibles à l'oeil nu, comme les corpuscules de Pacini, d'autres étant nettement plus petit comme les corpuscules de Meissner, ces derniers ayant une densité absolument particulière sur les principales zones d'appui, c'est à dire le talon, la partie externe du pied et surtout l'avant-pied. Finalement cette voûte plantaire se comporte un petit peu comme un capteur neuro-sensoriel, à la manière d'une plate-forme de force munie de capteurs de pression, lesquels récepteurs se répartissent essentiellement en trois types.
- Parmi les récepteurs de pression de la voûte
plantaire, on a l'habitude de distinguer:
- - Les plus superficiels qui sont les récepteurs de Merkel, récepteurs à adaptation lente,
- - Les récepteurs de Meissner qui sont situés dans une profondeur intermédiaire et réagissent à des fréquences de stimulation autour de 30 Hz,
- - Au niveau profond, les corpuscules de Pacini, qui réagissent
à des fréquences plus élevées autour de 250
Hz.
- Les corpuscules de Meissner sont enchâssés dans des protusions du derme à l'intérieur de l'épiderme, tandis que les récepteurs de Merkel sont au contraire distribués au sein de protusions intradermiques dans le derme. Les terminaisons nerveuses libres codant pour les récepteurs de la douleur et de la température pénètrent la couche basale de l'épiderme. Noter que les axones afférents se rejoignent pour former un plexus horizontal. Les corpuscules de Ruffini sont situés dans le derme tandis que les corpuscules de Pacini se situent dans le tissu sous-cutané.
- Certaines études expérimentales partant de ces données, permettent de corriger l'examen chez une personne donnée en analysant la sensibilité cutanée plantaire et l'examen postural.
- Ces expérimentations se font grâce à une plate-forme classique de statokinésigraphie et un certain nombre d'outils de mesures; le compas de Weber est utilisé sur le plan statique pour tester les récepteurs de type Merkel et sur le plan dynamique (grâce au test de Delon) les corpuscules de Meissner. Ces derniers peuvent être également être testés par le pied à coulisse de Weber, mais en lui injectant une vibration de 30 Hz fournie par un vibromètre, avec une possibilité de quantification par la tension d'excitation du vibreur.On peut également tester, avec un tel vibromètre, la sensibilité à 250 Hz des corpuscules de Pacini.
- On peut également utiliser pour tester la sensibilité cutanée plantaire les mono-filaments, qui sont des filaments relativement fins, bien calibrés et qui offrent des pressions calibrés et connus. Ces mono-filaments ont essentiellement été utilisés pour tester la sensibilité à la pression de la main et montrent que la sensibilité cutanée de la paume de la main est inférieure ou égale au filament D tandis que sur le pied, la sensibilité plantaire, en tous points de la zone plantaire hormis la zone talonnière qui est moins sensible du fait de l'épaisseur de la zone cornée, est autour du filament E ou F, toujours bien entendu pour un sujet normal (soit nettement plus sensible).
- Différentes études ont été réalisées avec ce type de matériel, d'abord chez des sujets normaux, ensuite chez des sujets pathologiques.
- Chez le sujet normal, en tous points de la plante du pied, en ce qui concerne la sensibilité vibratoire à 30 Hz et 250 Hz, elle est quasiment constante chez tous les sujets jusqu'à l'âge de 60 ans (tous ces sujets sont capables de percevoir une vibration autant à 30 Hz qu'à 250 Hz, pour une tension d'excitation de 0,1 volt).
- Si l'on s'intéresse à la variation de cette sensibilité durant les années, on constate effectivement qu'au delà de 60 ans, il existe un vieillissement progressif de la sensibilité plantaire, d'une part, parfaitement corrélée à un vieillissement des paramètres de l'équilibre mesurés sur plate-forme de statokinésimétrie, se traduisant par une augmentation de l'amplitude des oscillations mais aussi d'autre part une augmentation des fréquences sur les décompositions de FOURRIER.
- Il existe, de façon très nette, une corrélation très étroite entre le vieillissement de la sensibilité cutanée plantaire et la dégradation des paramètres statokinésigraphiques et stabilométriques, ceci aussi bien pour le test de Weber, le test de Delon que les tests vibratoires.
- A l'opposé, il y a peu de travaux sur la sensibilité plantaire de l'enfant car il n'est pas évident de la tester de façon fiable, en particulier s'il est très jeune. Les études que nous avons à notre disposition ne sont donc pas fiables.
- En ce qui concerne la pathologie, on rencontre des troubles de la sensibilité pour de grands nombres de pathologies: canal tarsien, sciatique tronculaire, polynévrite diabétique, sciatique radiculaire, maladie de Brown-Séquard, Tabès, maladie de Wallemberg, lacune thalamique, ématome pariétal, etc. ..
- Dans toutes ces pathologies , on a pu mettre en évidence des troubles de la sensibilité cutanée plantaire. Chez tous ces sujets, on trouve, dès la station bipodale, des troubles relativement importants en posturologie se traduisant essentiellement par l'augmentation des oscillations, c'est à dire des paramètres de surface, avec une grande majoration essentiellement en situation yeux fermés, et parfois des chutes.
- Finalement, la plupart des études montre que ces paramètres sont perturbés dès que les voies conduisant des capteurs de la sensibilité cutanée plantaire jusqu'au centre d'intégration sont perturbées à quelque niveau que ce soit. On peut même dire que l'analyse des troubles de la sensibilité plantaire est un diagnostic précoce des troubles sensitifs.
- Par ailleurs, certaines études expérimentales ont pu être faites par anesthésie plantaire.
- Le Docteur Enjalbert a effectué une étude portant sur les effets posturaux d'une anesthésie plantaire sur dix volontaires âgés de 21 à 35 ans, l'anesthésie étant effectuée par bloc du nerf tibial postérieur.
- Les paramètres mesurés ont étés, parmi les moyens déjà évoqués, les différents tests de sensibilité cutanée plantaire et une analyse posturale.
- Le contrôle de l'anesthésie par bloc du nerf tibial s'est fait par stimulation électrique pour repérer le nerf tibial postérieur, en demandant l'abolition d'une réponse motrice par contraction des muscles intrinsèques du pied.
- Dans cette étude, le pied anesthésié a été le pied droit, pied de la latéralité.
- Dès lors que l'anesthésie est obtenue, on retrouve sur plate-forme de statokinésimétrie, une augmentation des amplitudes d'oscillation, avec une prépondérance des fréquences d'oscillation voisine de 1 Hz. Quand le sujet passe en station unipodale sur le pied anesthésié on remarque une grande différence entre les paramètres mesurés en appui unipodal sur le pied anesthésié et ceux mesurés sur le pied sain et, si l'on rajoute l'occlusion des yeux, on peut généralement provoquer une chute, le plus souvent avant la troisième seconde.
- La conclusion de cette expérimentation est que le capteur podal joue un rôle totalement fondamental dans l'équilibration, jouant ainsi un petit peu le rôle d'une plate-forme de force. Il est permis de se demander, en comparaison de ce que l'on fait quand on explore le système tonique postural, si nous n'avons pas, en nous-même nos propres éléments de mesures, à savoir la voûte plantaire, qui serait notre véritable plate-forme de force, et nos capteurs céphaliques qui seraient des détecteurs du mouvement, avec entre les deux, toute une chaîne de récepteurs cutanés musculaires et articulaires, qui nous permettent de réguler l'angulation entre les différents segments de notre corps et d'avoir une idée de notre schéma corporel.
- Il est beaucoup plus difficile d'envisager le rôle respectif des différents récepteurs cutanés plantaires. Il est particulièrement difficile, entre autres, de faire la part entre ce qui est récepteur musculaire et récepteur cutané. En particulier dans l'expérience d'Enjalbert, il a pu être démontré qu'il persistait une sensibilité musculaire, malgré l'anesthésie, alors que la peau était tout à fait anesthésiée.
- Il serait difficilement envisageable de faire des anesthésies plus partielles au niveau de la plante du pied ou plus superficielles, par exemple par gel anesthésique, ce qui permettrait de faire la différence entre les capteurs superficiels et les capteurs profonds.
- En résumé, on pourrait dire qu'au niveau du capteur podal, et de son rôle dans l'équilibration, on a deux types de capteurs, des récepteurs musculaires et des récepteurs cutanés.
- On pourrait donc envisager qu'il est nécessaire dans la station debout de disposer de deux types d'information pour réguler celle-ci. Il faut sur le plan dynamique, en effet, deux types d'informations: une première information nous fournit l'état des commandes, dévolues aux organes moteurs eux-mêmes , c'est à dire les récepteurs tendino-musculaires. Mais cela ne suffirait pas à réguler notre posture. Il nous faut donc des détecteurs d'erreurs, rôle dévolu aux récepteurs cutanés, essentiellement récepteurs cutanés profonds et corpuscules de Pacini, avec les arguments que nous venons de voir, à la fois anatomo-physiologiques et expérimentaux.
- Au niveau thérapeutique, cela a bien sûr
une incidence considérable puisque la stimulation sensitive cutanée
devrait faire partie des moyens thérapeutiques au même titre
que la reprogrammation motrice.
- L'action des centres supérieurs est une action d'intégration et de contrôle.
- En effet, les influx nerveux provenant des capteurs sensoriels que nous avons décrits aboutissent vers des structures qui sont sous-corticales et corticales. Ces structures ont une action intégrative permettant le contrôle de l'ensemble du système tonique postural par un certain nombre de réflexes.
- Le réflexe vestibulo-oculaire permet le contrôle de la stabilisation du regard ainsi que le réflexe visuo-oculomoteur tandis que les réflexes vestibulo-spinal et vestibulo-oculo-cervical permettent le contrôle global et le maintien de la posture par leur action sur le réflexe myotatique.
- Parmi les structures responsables du contrôle central, l'un des grands carrefours est constitué par le complexe nucléaire vestibulaire, qui reçoit des informations en provenance du système limbique, du coliculus, du thalamus et de divers noyaux , du cervelet et du cortex cérébral. Il est formé de quatre noyaux, il reçoit les influx en provenance des labyrinthes, mais également des afférences visuelles, les messages rétiniens transitant au niveau du tractus optique, du système optique accessoire avant d'arriver au niveau du complexe nucléaire vestibulaire par l'intermédiaire de l'olive inférieure du cervelet et du prepositus hypoglossi.
- Les afférences spinales rejoignent également la partie dorsale du complexe nucléaire vestibulaire, latéral, médian et descendant, constituant ainsi un système spino-vestibulaire médian, issu des étages cervicaux, et latéral, provenant des étages dorsaux et lombaires.
- Par ailleurs, il existe des projections indirectes passant par le coliculus et la réticulée en provenance des récepteurs proprioceptifs des muscles extra-oculaires.
- Le cervelet possède un rôle de contrôle parce qu'il possède des connections à la fois efférentes et afférentes avec le complexe nucléaire vestibulaire.
- Parmi les autres structures de contrôle citons le noyau rouge, impliqué dans le contrôle de la motricité de la face et des membres en assurant la régularité et la précision des mouvements, le néo-cervelet, agissant par l'intermédiaire des noyaux dentelés dans l'initialisation motrice et l'apprentissage interne du mouvement, la substance réticulée qui reçoit des fibres de la sensibilité somesthésique et joue un rôle sur l'activation globale du système.
- Les différents centres nerveux recevant des informations en provenance des différents capteurs sensoriels élaborent une réponse motrice au sens large du terme, sous forme de différents influx transmis à des effecteurs.
- Ils ont comme substratum les systèmes musculo-tendineux et ostéo-ligamentaires, somatiques et oculaires et permettent une correction permanente.
- C'est en fait essentiellement au niveau du rachis, qui
contient l'ensemble des capteurs de la kinesthésie tels que nous
les avons décrits, que l'effecteur musculaire revêt sa plus
grande importance puisqu'il conditionne entièrement attitudes vicieuses,
dystonies segmentaires et plus tard les dystaties vraies qui peuvent éventuellement
en naître. A signaler, au niveau du rachis, un rôle particulier
des récepteurs cervicaux, très nombreux chez l'homme, ayant
une action privilégiée en cas de déficit labyrinthique.
| La voûte plantaire est innervée par un seul
et même nerf, le nerf tibial postérieur. Ce nerf se divise
en trois branches: le nerf calcanéen interne qui innerve la zone
talonnière, le nerf plantaire interne et le nerf plantaire externe
qui se répartissent la plupart de l'innervation de la voûte
plantaire, sauf un petit filet du nerf saphène interne qui innerve
une petite zone de l'arche interne.
Innervation de la voûte plantaire |
|
|
Sensibilité en fréquence des différents récepteurs de la sole plantaire. |
Les capteurs neuro-sensoriels de la voûte plantaire.
|
Distribution typique des récepteurs |
|
Dessin schématique d'une terminaison de Ruffini
|
Dessins de terminaisons nerveuses libres
|
Disques de Merkel. |
LA REGULATION CENTRALE
L'EFFECTEUR MUSCULAIRE
SYNTHESE
- Le système tonique postural est un système
auto-asservi, multimodal (capable de fonctionner de plusieurs façons
différentes) et multiplexé (combinant de multiples informations
d'origines différentes) dont la seule stratégie est le maintient
de la projection au sol du centre de gravité à l'intérieur
du polygone de sustentation, quelle que soit la tactique pour y parvenir,
même si, par nécessité, celle est déstabilisante,
déformante ou douloureuse. Certaines études montrent d'ailleurs
que ces choix tactiques, pas toujours heureux, se font selon des effets
de seuils d'alerte au sein des répertoires moteurs. La précision
du système tonique postural est extrême.
- Le contrôle postural est dévolu aux centres
supérieurs, lesquels doivent être informés:
- Ceci peut être résumé sur les deux
schémas suivants.
![]()
PARTIE II :CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE POSTURALES |
SIGNES D'APPEL
SIGNES D'EXAMEN: LE BILAN POSTURAL
EXAMEN DE L'EQUILIBRE TONIQUE STATIQUE SEGMENTAIRE
- Il s'agit de tests consistant à demander au sujet de décrire la perception de la position de ses différents segments osseux les uns par rapport aux autres. Il font appel autant à la proprioception qu'à l'extéroception; ce sont des tests somesthésiques globaux.
- Concernant l'équilibre tonique des muscles paravertébraux, il s'agit essentiellement d'une manoeuvre palpatoire et il faut comparer le tonus en position debout et en position couchée. En position debout, il est aussi possible d'effectuer la manoeuvre des pouces ou manoeuvre de Basani, qui est un équivalent.
Au niveau des membres inférieurs:
Les tests de Da Cunha
Au niveau du rachis:
Appréciation des dystonies segmentaires par la palpation.
A signaler également au niveau des muscles paravertébraux, la recherche des cordes par la palpation, signes d'hypertonie; leur découverte est toujours intéressante, de même la palpation de l'enfoncement des épineuses, signe majeur de conflit hypertonique.
Rappel: une hypertonie entraîne une élévation
des repères osseux au cours de la flexion du rachis.
Le Romberg postural.
- Le test de Romberg postural consiste à
observer ce qui se passe chez le sujet debout lorsqu'il ferme les yeux,
testant ainsi la proprioception plantaire et rachidienne, mais dans des
conditions particulières. Le sujet est examiné debout, talons
joints, pieds à 30°, bras tendus à l'horizontale devant
lui, les mains fermement accolées par leur bord radial. On repère
alors la déviation des index dans l'espace, la latérodéviation
de la tête, l'inclinaison de l'axe bi-pupillaire, et ceci pendant
20 secondes avant et après occlusion des yeux. Là encore,
l'examen peut être automatisé sur un craniocorpographe.
- Elle se fait idéalement par système de vision assistée par ordinateur (système STATIS), lequel fourni de nombreux autres renseignement supplémentaires, mais permet surtout dans ce cas une grande précision et une comparaison par rapport à une population témoin.
- La verticale de Barré est un test fiable s'il est mesuré correctement. C'est l'un des tests posturaux les plus difficile à modifier, sa correction est donc hautement significative.
- La position des pieds au sol est importante: ils doivent former entre eux un angle de 30°, les talons doivent être écartés de 2 cm. environ. Le sujet doit rester immobile, détendu, bras le long du corps, regardant à hauteur des yeux. La mesure se fait à l'aide d'un fil à plomb, centré au milieu du plan inter malléolaire, ou mieux au craniocorpographe (système STATIS).
- Lorsque les oscillations posturales du sujet sont trop importantes, la position de la verticale inter malléolaire par rapport au pli fessier peut être notée par les positions extrêmes qu'elle atteint. L'existence de telles oscillations mérite par ailleurs d'être notée pour elle-même.
- La verticale de Barré est un test d'équilibre tonique et statique global.
- La verticale de Barré peut aussi être mesurée
de profil (voir dessin) et dans le plan horizontal (voir photo ci dessous)
afin de déterminer les rotations axiales des vertèbres et
des ceintures. Dans ce dernier cas, on mesure les tangentes d'un regard
plongeant, en prenant comme référence le plan postérieur
passant en arrière des talons. La somme des rotations élémentaires
des corps vertébraux lombaires et dorsaux apparaît comme la
différence entre les rotations axiales des épaules et du
bassin.
La manoeuvre de Basani ou "test des pouces montants".
L'appréciation des bascules des ceintures.
Mesure des bascules des ceintures. |
La verticale de Barré (Face et Profil).
La verticale de Barré (de face) |
La verticale de Barré (de profil) |
Appréciation visuelle d'une rotation de la ceinture pelvienne (vue plongeante) |
Membres supérieurs:
Test de Cyon (plutôt
cognitif).
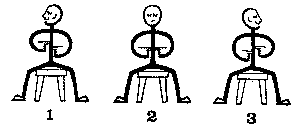 |
EXAMEN DE L'EQUILIBRE TONIQUE EN DYNAMIQUE
- Le test le plus important, à bien connaître
et bien maîtriser, est le test de piétinement de Fukuda.
Tout sujet normal qui piétine sur place les yeux fermés ne tourne sur lui-même que de 20° à 30° maximum en 50 pas.
- On note la différence entre les angles de spin
par rapport à la position en tête neutre, dite gain nucal.
Puis l'on compare ces deux gains pour en déduire la prépondérance
tonique posturale.
La méthode de calcul n'étant pas évidente à assimiler (comme toute convention), il faut respecter les étapes suivantes:- - Noter sur la piste de Fukuda les différentes positions en fin de chacun des trois tests
- - Calculer les gains droit et gauche en faisant leur somme absolue (leur différence angulaire)
- - Affecter à chaque gain un signe + si physiologique, - si anti physiologique (par rapport à sa position en tête neutre)
- - Pour le côté de la prépondérance, on compare les gains et l'on regarde de quel côté il a été le plus physiologique (le meilleur, ou le moins mauvais !)
- - Pour calculer sa valeur, on fait la somme algébrique des gains.
- Le test de Fukuda avec mesure du gain nucal est le plus fiable des tests destinés à mesurer le tonus des membres inférieurs, mais aussi le réflexe vestibulo-spinal.
- A noter qu'il est impossible de se baser sur le seul test de piétinement pratiqué en position neutre de la tête car le spin observé alors peut être dû aussi bien aux muscles rotateurs externes de la cuisse, psoas principalement, qu'aux muscles extenseurs du membre inférieur.
- Nous verrons ultérieurement au chapitre des examens paracliniques que celui-ci peut être effectué de façon plus précise et en décomposant ses différentes phases à l'aide d'un craniocorpographe.
- La rotation (spin) de l'axe du corps se fait en sens opposé à la rotation cervicale.
- Absence de toute source sonore ou lumineuse
- Elévation suffisante des cuisses, à 45° environ
- Fréquence du pas de 80 par minute environ
- Position primaire des yeux à l'occlusion
- Tête en position neutre, puis tournée à droite, puis à gauche
- Pas de chaussure, si possible pieds nus
- Mâchoires en position de posture mandibulaire après déglutition (les dents ne se touchent pas)
- Il est commode de se servir d'une piste de Fukuda
EXAMEN DES REFLEXES POSTURAUX
Le réflexe nucal du test de piétinement de Fukuda
Le réflexe nucal de la manoeuvre de Cyon
- L'index le plus haut doit se situer du coté de la rotation cervicale.
- La déviation de la base du cou doit être
controlatérale à la déviation du regard.
Le
réflexe oculomoteur orthostatique : la réaction oculo-posturale
Le réflexe labyrinthique
- Fauteuil de Barany
- Rotation de 2 tours en 10 secondes
- Puis test de Fukuda, TN
- La rotation du Fukuda doit être dans le même
sens que la rotation du fauteuil de Barany
EXAMEN DES REACTIONS D'EQUILIBRATION
Le Romberg postural à nouveau
- Yeux ouverts
- Pieds à 30°
- Bras tendus fermement accolés
- On regarde:
- - axe bi-pupillaire (utiliser une grille transparente)
- - position des index
- - position extrême des oscillations de la base du cou
- Yeux fermés
- Déplacement des index et de la base du cou
- Chez le sujet normal: tourne du coté droit, se
penche à gauche si axe bi-pupillaire pencé à droite.
(1) ou tourne à gauche et se penche à droite si axe bi-pupillaire
pencé à gauche.(4) 2 et 3 sont les deux positions de départ.
- Faire un Romberg postural avec un seul oeil fermé. Seul l'oeil postural provoque la réaction.
- Les déséquilibres toniques posturaux altèrent les gestes fins et précis.
- Il faut donc ajouter un interrogatoire et un examen de l'activité gestuelle.
- Test de la clé, enfiler un fil dans une aiguille, poser une casserole sur le feu.
- Test de la clé:
- - trou à 90 cm du sol
- - pied de la latéralité à 25 cm du plan de la serrure
- - gauche en arrière. , angle de 60o
- - geste allant de la cuisse au trou
- - 10 impacts en 17 secondes
- - Deux séries
Détermination de l'oeil postural
Examen de la gestuelle
LES SIGNES PARACLINIQUES
- Essentiellement deux examens sont utiles: la stabilométrie et la vidéocorpographie (statique et dynamique).
- Nous ne détaillerons pas ici leur modalités de réalisation et d'interprétation.
CONCLUSION DE L'EXAMEN POSTURAL: EXISTE-T-IL UN SYNDROME POSTURAL ?
CRITERES CLINIQUES
- Localiser sur un "bonhomme" les hypertonies des muscles axiaux et distaux.
- Muscles axiaux : paravertébraux et oculocéphalogyres
- Muscles distaux : membres supérieurs y compris trapèze et membres inférieurs.
- On définit un syndrome postural par la constatation d'une hypertonie systématisée touchant les muscles axiaux d'un seul coté et les muscles distaux d'un seul coté aussi.
- Principalement deux configurations générales peuvent se voir: syndrome postural harmonique ou dysharmonique, à partir de l'équilibre tonique général.
- Normalement, le tonus musculaire prédomine sur les extenseurs d'un membre inférieur, ouvrant l'angle de l'articulation tibio-tarsienne ce qui repousse en arrière les masses fessières du même coté, entraînant une discrète rotation du bassin.
- De même, au niveau des gouttières paravertébrales, on trouve normalement une hypertonie des muscles d'un coté, ce qui incline la tête.
- La frontière entre ces attitudes normales et le
syndrome postural, pathologique, est difficile à cerner.
- On peut se baser cependant sur:
- - Une verticale de Barré loin du pli fessier,
- - Une position moyenne en X sur le statokinésigramme loin de la normalité.
- Cas des hypertonies non systématisées.
- Il ne s'agit pas d'un syndrome postural.
- Le plus souvent, simples contraintes locales au niveau
du rachis (capteur postural) dans les troubles axiaux, cas encore discuté
dans les troubles distaux où l'on donne généralement
la priorité au capteur podal pour des raisons d'importance posturale.
LE TRAITEMENT: LA MANIPULATION DES ENTREES POSTURALES ET ASSIMILEES
ENTREE VISUELLE
- L'idéal est d'avoir un jeu de prismes, que l'on teste par la manoeuvre des rotateurs.
- Seul l'oeil postural doit être testé
- Sans oublier l'évaluation sur plateforme.
- - Test des rotateurs avec et sans intercuspidation. (BO,BF,BFM inter pré-molaire/molaire)
- - Test de Fukuda
- Si l'un quelconque de ces tests est répétitivement influencé, la démarche première est de régler l'occlusion. Encore faut-il qu'aucun des tests présentés ne soit aggravé par la situation BFM.
- Sans oublier, là encore, les test sur plateforme.
SYSTEME MANDUCATEUR
Les décisions se font selon le tableau suivant:
| Que signifie | Sujet normal | Problème occlusal secondaire | Problème occlusal primaire |
| Bouche ouverte | = | # | = |
| Bouche fermée | = | # | # |
| BFM | = | # | = |
| Que faire ? | RIEN | TRAITER LA POSTURE | TRAITER L'OCCLUSION |
ENTREE PODALE
- Nous pouvons influencer ce capteur et donc le système tonique postural en agissant au niveau de ses deux composantes neurologiques principales: extéroception et proprioception.
- Savoir quand et comment traiter le capteur podal est l'objet de ce chapitre.
- Vouloir tout traiter à partir du pied est totalement déraisonnable.
- Par l'anamnèse et la localisation des douleurs dans les syndromes douloureux, par la prépondérance lombaire ou pelvienne des déformations dans les syndromes dystoniques et dystatiques, par l'analyse stabilométrique et statokinésigraphique dans les syndromes dynamiques (de type troubles de l'équilibre).
- Nous ne discuterons pas des anomalies mécaniques du pied, qui sont du ressort des podologues qui connaissent bien ces problèmes-là.
- Le test des rotateurs n'est pas à conseiller chez les gens qui n'en ont l'habitude car il amène à des diagnostics par excès ou par défaut, il est cependant l'un des test les plus intéressants, d'où la nécessité d'en apprendre la pratique et d'en connaître les limites .
- Enfin, on peut utiliser le Romberg postural.
- La vérification de l'efficacité d'une orthèse ou d'un autre geste térapeutique s'effectue à travers la normalisation du signe des pouces et la disparition ou la diminution nette des asymétries toniques posturales. Il peut aussi se faire sur la normalisation des hypertonies par la manoeuvre de Fukuda, test dynamique, ou par la normalisation du Romberg postural, test tonique.
- Attention!... Toute intervention efficace sur le capteur podal va provoquer la normalisation d'un certain nombre de tests, cela n'implique pas nécessairement que le capteur podal soit vraiment à l'origine du trouble postural, mais il est vrai que, dans bon nombre de cas, son traitement, s'il est bien conduit, peut momentanément être suffisant pour que le système tonique postural retrouve un degré de régulation.
- Il est donc nécessaire de contrôle à nouveau le traitement provoqué par la semelle, quinze jours à un mois après.
- Comment déterminer la place du pied dans un traitement tonique postural général? Ceci relève généralement d'un bon interrogatoire et d'un bon examen clinique. Pour le podologue, la meilleure mesure reste le bilan sur plate-forme de statokinésigraphie.
- Règles générales de correction: plusieurs méthodes peuvent être utilisées.
Quand faut-il penser au capteur podal?
A priori toujours. Quand on travaille en posturologie, il est l'un des sommets du triangle postural: oeil, Vestibule, Pied.
Comment reconnaître une pathologie du capteur podal?
Stimulation par microcales des zones réagissant au test des rotateurs (méthode de réeducation passive)
On utilise généralement des éléments (sous-capital externe, antéro-externe, medio-interne, postéro-externe ou sous-tubérositaire interne ) et des barres (sous-capitale, rétrocapitale ou antérieure, médiane, postérieure ou sous-tubérositaire).- On choisit un élément de correction capable de stabiliser (symétriser) l'hypertonie. On contrôle son activité debout par un nouveau test de Fukuda, et localement par la manoeuvre de Basani. Si le test des rotateurs est maîtrisé correctement par le praticien, son utilisation est rapide et riche d'enseignements.
- Une autre possibilité est l'utilisation des microcales de type Bourdiol.
- Règles générales.
- En cas d'hypertonie des chaînes postérieures, on met une barre rétrocapitale, en cas d'hypertonie des chaînes antérieures, une barre pré-calcanéenne quand la pathologie s'exprime dans le plan sagittal, ce traitement agit par l'intermédiaire du contexte achiléo-suro-plantaire.
- Quand la pathologie s'exprime dans le plan frontal, on tient compte des composantes latérales d'adduction - abduction par l'intermédiaire de l'arrière pied et du complexe achiléo-suro-plantaire.
- Si la déviation de l'axe calcanéen est en valgus, on met un coin calcanéen interne, si la déviation de l'axe calcanéen est en varus, un coin calcanéen externe.
- Si la pathologie s'exprime dans le plan frontal, lors de l'appui au niveau de l'avant-pied, on agit sur le complexe achiléo-suro-plantaire et l'avant-pied dans sa composante statique stabilisatrice. On utilise des coins sous-capitaux internes ou externes.
- Quand la pathologie s'exprime au niveau des chaînes croisées, on utilise des orthèses placées en latéro-calcanéen et en sous-capital.
- Si la pathologie concerne tout le système postural on préfère dans ces cas utiliser des orthèses thermoformées.
- Il s'agit des circuits de neuro-stimulation active de type Neurostab.
- Les indications: toute pathologie quelle qu'elle soit de l'entrée podale du système tonique postural, car leur action est essentiellement régulative. Attention cependant, il s'agit d'une méthode récente, certes sans danger possible ou potentiel, mais qui peut être mal perçue en l'absence d'explication et qui pourrait être confondue avec des techniques charlatanesques et non efficaces (semelles magnétiques, de stimulation de points "énergétiques", etc..)
- Une seule contre-indication relative: Les compensations podales.
Le traitement de l'extéroception (méthode de rééducation active)
BIBLIOGRAPHIE SUCCINTE
- 1 - Batini C., Buisseret P., Lassère M.A. & Toupet M. (1985) - La proprioception des muscles extrinsèques de l'oeil participe-t-elle à l'équilibre, à la vision et à l'oculomotricité ? - Ann. Otolaryngol., 102:7-18.
- 2 - Bell Ch. (1837) - The hand. Its mechanisms and vital environment. V. Pickering, London,4ème édition.
- 3 - Berthoz A. (1987) - Influence of gaze on vestibulospinal and reticulospinal control of posture and movement. Proceedings of the satellite symposium to Barany Society Meeting - Bologne.
- 4 - Berthoz A., Lacour M., Schoeting J. & Vidal P.P. (1979) - The role of vision in the control of posture during linear motion. (Ed. O. Pompeiano & R. Grant). "Reflex control of movement and posture"(pp. 197-209), Elsevier, Amsterdam.
- 5 - Black F.O., Wall C. & Nashner L.M. (1983) - Effects of visual and support surface orientation references upon postural control in vestibular deficient subjects. Acta Otolaryngol. (Stockh.), 95, 3-4: 199-210.
- 6- Buisseret P. & Gary-Bobo E. (1979) - Development of visual cortical orientation specificity after dark-rearing: role of extra-ocular proprioception. Neurosc. letters, 13 : 259-263.
- 7- Clément G. (1986) - Influence de la gravité sur les mécanismes adaptatifs du contrôle postural. Tèse de sciences, Paris VII.
- 8 - Cyon E. (1911) - L'oreille, organe d'orientation dans le temps et dans l'espace. Alcan, Paris.
- 9 - Da Cunha H.M. & Da Silva O.A. (1986) - Perturbations de la fonction binoculaire dans le syndrome de déficience posturale. Agressologie, 27, 1:63-68
- 10 - Fukuda T. (1959) - The stepping test.Two phasis of the labyrinthin reflex.Acta Otolaryngol. (Stockh.) 50,2: 95-108.
- 11 - Fukuda T. (1961) - Studies on human dynamic posture from the viewpoint of postural reflexes. Acta Otolaryngol. Supp. 161.
- 12 - Gagey P.M., Bizzo G., Gentaz R., Guillaume P. & Marruchi C. (1986) - Huits leçons de posturologie. Association Française de Posturologie. Paris.
- 13 - Hein A. (1987) - La structuration de l'espace visuel peut-elle se développer en l'absence des informations proprioceptives oculomotrices ? Critiq. Post., Paris, 12:1-4.
- 14 - Longet F.A. (1845) - Sur les troubles qui surviennent dans l'équilibration, la station et la locomotion des animaux après la section des parties molles de la nuque. Gaz. Méd. , Paris, 13:565-567.
- 15 - Marruchi C., Bodot C., Hodowanskyj F. & Gagey P.M. (1986) - Romberg's quotient of Njiokiktjien among children. Eig symposium of the international society of posturography, Amsterdam : Proceed 72.
- 16 - Nashner L.M. (1987) - Normal organization of sensory inputs to human posture. Proceed of satellite symposium, Barany Society Meeting, Bologne.
- 17 - Rauquet J. (1953) - Essai d'objectivation de l'équilibre normal et pathologique. Tèse Médecine, Paris.
- 18 - Reydy R. (1987) - Synergie entre l'information visuelle et la proprioception oculomotrice dans le système postural. I. Congresso Iberico de Estrabismo, Lisbonne,mars 1987.
- 19 - Uemura T. & Cohen B. (1973) - Effects of vestibular nuclei lesions on vestibulo-ocular reflexes and posture on Monkeys. Acta Otolaryngol., Supp. 315.
- 20 - Unterberger S. (1938) - Neue objective registierbare Vestibulo-Drehereaktion, erhhalten durch Treten auf des Stelle. Der "Tertversuc". Arch. Klin. Exp. Ohr-Nas-Kehlokop., 145:478-482.
- 21 - Ushio N., Hinoki M., Baron J.B., Gagey P.M. & Meyer J. (1976) - The stepping test with neck torsion: proposal of a new equilibrium test for cerviacl vertigo. Pract. Otol. (Kyoto), 69, Supp. 3 : 1369-1379. (En japonais).
- 22 - Utermöhlen G.P. (1947) - De prismatherapie geotest aan 160 lijders aan het syndroom van Ménière. Nederl. Tijdscher. v. geneek., 91 : 124-126.
- 23 - Vierordt K. (1864) - Grundzüge der Physiologie des Menschen. Berlin.
- 24 - Weber B., Gagey P.M. & Noto R. (1984) - La répétition de l'épreuve modifie-t-elle l'éxécution du test de Fukuda ? Agressologie, 25, 12: 1311-1314.
- 25 - Van Parys J.A.P. & Njiotitjien Ch. (1976) - Romberg's sign expressed as a quotient. Agressologie, 17, 3 : 95-100.

Sommaire général
Sommaire posturologie